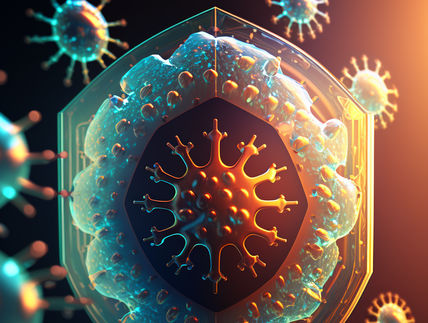Cellules tueuses : comment le système immunitaire sélectionne ses troupes de défense
Des chercheurs étudient un processus biologique fondamental chez des sujets vaccinés
Lorsque les cellules tueuses du système immunitaire rencontrent des signes d'infection, certaines d'entre elles se divisent ensuite rapidement. Elles se développent ainsi en une grande force de défense qui combat ensuite l'agent pathogène. Cependant, ce n'est pas le cas de toutes les cellules tueuses. Quel est le critère qui détermine s'il y a multiplication ou non ? Des chercheurs de l'université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg (FAU), de la clinique universitaire d'Erlangen et de Helmholtz Munich se sont penchés sur cette question. Pour ce faire, ils ont étudié des personnes qui avaient reçu un vaccin Covid. Chez eux, seules les cellules dont la "force de frappe" par rapport à la caractéristique du virus vacciné dépassait un certain seuil se sont ensuite divisées. Les résultats sont publiés dans la revue spécialisée Science Immunology.
Les agents pathogènes peuvent avoir une apparence très différente. Pourtant, le système immunitaire parvient généralement à les détecter rapidement. Il doit notamment cette capacité aux quelque 100 millions de variétés différentes de cellules T cytotoxiques (également appelées cellules tueuses) qui montent la garde dans tout le corps. Chacune d'entre elles est entraînée à reconnaître les molécules étrangères à l'organisme, comme celles d'un intrus potentiel. Cependant, chacune de ces variétés est à l'affût d'un signal d'alerte différent : Certaines cellules tueuses donnent par exemple l'alerte lorsqu'elles rencontrent une molécule du virus de la grippe. D'autres, en revanche, sont peut-être activées par une protéine tumorale spéciale.
Ce sont des capteurs à la surface des cellules tueuses - les récepteurs des cellules T - qui en sont responsables. Ils réagissent à des signes de reconnaissance moléculaires très spécifiques, qui peuvent être très différents selon le type de récepteur. "Nous appelons ces signes de reconnaissance des antigènes", explique le professeur Kilian Schober, de l'Institut de microbiologie - microbiologie clinique, immunologie et hygiène (directeur : professeur Christian Bogdan) à l'hôpital universitaire d'Erlangen. "Les récepteurs des cellules T peuvent se lier aux antigènes - mais seulement s'ils leur correspondent exactement, un peu comme une clé à une serrure".
Les "guerriers clones" du système immunitaire
Lorsque cela se produit, la cellule tueuse peut commencer à se diviser rapidement. Il en résulte toute une armée de cellules identiques - un clone. Elles disposent toutes du même récepteur de cellules T que la cellule mère, peuvent donc également reconnaître l'antigène correspondant et combattre la cellule porteuse de l'antigène. Mais la liaison à un fragment de molécule étranger au corps n'entraîne pas toujours une multiplication de la cellule immunitaire concernée, loin s'en faut. "Nous voulions savoir à quoi cela était dû", explique Schober. "Pour cela, nous avons observé la réponse immunitaire de sujets qui avaient reçu un vaccin à ARNm pendant la pandémie de Covid".
Les vaccins à ARNm font en sorte que les cellules du corps fabriquent un fragment de protéine spécifique du virus Corona. Ce fragment est ensuite détecté par des récepteurs qui lui correspondent et peut ainsi activer les cellules tueuses correspondantes. En cas d'infection réelle, le corps peut alors combattre rapidement l'agent pathogène. En règle générale, il existe plusieurs centaines de récepteurs de cellules T qui peuvent se fixer sur la protéine virale. Toutefois, certains d'entre eux sont plus adaptés que d'autres - ils se lient donc plus fortement. Dans le jargon technique, on dit qu'ils possèdent une "avidité" plus élevée. "Nous avons maintenant pu montrer que les cellules tueuses ne sont incitées à se diviser que lorsque leur avidité dépasse une certaine valeur seuil", explique Schober.
La diversité augmente la force de frappe contre les mutants
Sur les quelques centaines de lignées cellulaires, il en reste ainsi quelques dizaines, chacune formant un clone de cellules immunitaires. "Ce n'est toutefois pas comme si les cellules tueuses avec la plus grande avidité se multipliaient le plus", souligne la doctorante de Schober, Katharina Kocher, qui a réalisé une grande partie des expériences. "Elles doivent avoir un certain niveau d'avidité minimum pour pouvoir se diviser. Mais la force avec laquelle elles le font et la taille du clone de cellules immunitaires qui en résulte semblent dépendre du hasard". Peu après la vaccination, le système immunitaire des personnes testées a donc produit entre vingt et trente clones de cellules tueuses de tailles différentes. Chacun d'entre eux disposait d'un récepteur de cellules T différent, et pourtant tous ont pu se lier suffisamment fortement à la protéine virale formée après la vaccination.
Cette diversité des troupes de défense est un grand avantage, comme les chercheurs ont pu le démontrer expérimentalement : "Si le virus mute au fil du temps, la probabilité qu'il y ait toujours des cellules tueuses capables de le combattre augmente ainsi", explique Schober. "En revanche, un clone unique - aussi élevée que soit son avidité - ne pourrait jamais couvrir tous les mutants possibles".
C'est justement à partir des humains que de telles analyses sont encore rares. Cela s'explique aussi par l'énorme effort que les chercheurs ont dû fournir pour y parvenir : "Nous avons examiné plusieurs milliers de cellules tueuses chez chaque personne testée et analysé la structure de leurs récepteurs", explique Schober. "Ensuite, nous avons reproduit plus d'une centaine de récepteurs individuels dans un système de test afin de pouvoir mesurer son avidité". Mais selon lui, l'effort en valait la peine. "Les résultats de notre étude permettent d'avoir un aperçu intéressant des stratégies du système immunitaire, dont le développement de nouveaux vaccins pourrait éventuellement profiter à l'avenir".
Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Allemand peut être trouvé ici.
Publication originale
Katharina Kocher, Felix Drost, Abel Mekonnen Tesfaye, Carolin Moosmann, Christine Schülein, Myriam Grotz, Elvira D’Ippolito, Frederik Graw, Bernd Spriewald, Dirk H. Busch, Christian Bogdan, Matthias Tenbusch, Benjamin Schubert, Kilian Schober; "Vaccination-induced T cell responses maintain polyclonality with high antigen receptor avidity"; Science Immunology, Volume 10