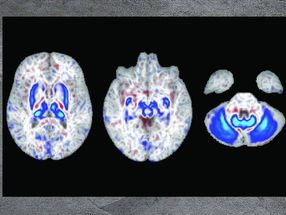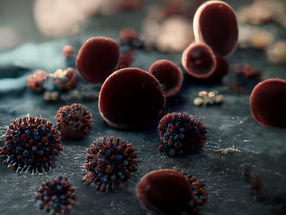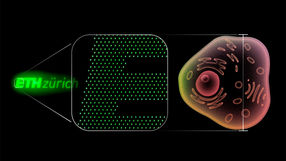Génétique des accidents vasculaires cérébraux : des mécanismes HTRA1 indépendants augmentent le risque
Des chercheurs ont découvert deux façons indépendantes par lesquelles des variantes génétiques augmentent le risque de maladies cardiovasculaires
Les maladies cardiovasculaires, y compris les accidents vasculaires cérébraux et les maladies coronariennes, sont l'une des principales causes de décès dans le monde. Les facteurs de risque classiques sont l'âge, le mode de vie personnel et les maladies préexistantes, mais les prédispositions génétiques jouent également un rôle. "Des études d'association à grande échelle sur le génome ont permis d'identifier de nombreux gènes qui influencent le risque d'accident vasculaire cérébral et de maladie cardiovasculaire", explique Martin Dichgans, professeur à l'Université de Louvain. "Elles ont également montré que l'information génétique peut être utilisée pour découvrir des cibles médicamenteuses potentielles pour des thérapies ciblées.
Directeur de l'Institut de recherche sur les accidents vasculaires cérébraux et la démence à l'hôpital universitaire LMU et scientifique au sein du pôle d'excellence SyNergy, Dichgans est l'investigateur principal d'une étude qui vient d'être publiée dans la revue Nature Cardiovascular Research. L'étude a porté sur l'étude approfondie du gène HTRA1, qui code pour une protéase - une enzyme qui a un effet régulateur sur la matrice extracellulaire. "Le gèneHTRA1 s'est avéré être un gène de risque pour divers troubles, notamment les accidents vasculaires cérébraux et les maladies des petits vaisseaux cérébraux", explique le chercheur spécialiste des accidents vasculaires cérébraux et de la démence. Les personnes qui héritent de variantes spécifiques du gène sont beaucoup plus susceptibles de souffrir de ces affections. Toutefois, les mécanismes sous-jacents à ce risque accru n'étaient pas encore suffisamment compris.
Perte de fonction et diminution de la concentration
Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont comblé une partie importante de cette lacune. En intégrant les informations cliniques et génétiques de grandes biobanques aux résultats d'expériences biochimiques ciblées, ils ont étudié les effets de 78 variantes de HTRA1 sur la fonction enzymatique de la protéase. "Nous avons pu démontrer deux mécanismes indépendants par lesquels des variantes rares et communes du gène affectent le risque cardiovasculaire", résume la chercheuse postdoctorale Nathalie Beaufort, l'un des auteurs principaux. Alors que certains variants rares de HTRA1 réduisent l'activité de la protéase, d'autres variants plus communs entraînent une diminution de la concentration de l'enzyme dans le sang. "Nos résultats indiquent que l'activité et la concentration de HTRA1 doivent être prises en compte dans les applications cliniques futures", déclare Beaufort.
"Les deux mécanismes augmentent le risque d'accident vasculaire cérébral et de maladie coronarienne", ajoute le chercheur postdoctoral Rainer Malik, autre auteur principal de l'étude. "Cependant, ils sont indépendants l'un de l'autre et ont des effets différents sur des phénotypes différents. Les variantes génétiques rares qui entraînent une perte d'activité de la protéase, par exemple, sont en outre associées à certains traits squelettiques. En revanche, la variante commune - qui affecte la concentration des protéines - réduit le risque de migraines et de certaines maladies dégénératives de l'œil.
Le risque cardiovasculaire n'est pas le seul à être influencé
Les nouvelles découvertes influenceront également les futures stratégies thérapeutiques. En principe, le risque cardiovasculaire pourrait être réduit en rétablissant l'activité de la protéine HTRA1 ou en augmentant sa concentration. "Cependant, comme le montre notre étude, une augmentation de la concentration de HTRA1 entraîne un risque élevé de dégénérescence maculaire liée à l'âge et d'autres troubles rétiniens", explique Malik. Cela souligne la nécessité de développer des thérapies spécifiques à un organe ou à un type de cellule.
"Jusqu'à présent, les scientifiques ont examiné la relation entre HTRA1 et la maladie en termes binaires", note M. Dichgans. "Nos résultats montrent qu'il est important de considérer l'activité de HTRA1 comme un phénotype continu. À l'avenir, les chercheurs ont l'intention de découvrir comment les variantes du gène affectent différents types de cellules et de tissus.
Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.
Publication originale
Rainer Malik, Nathalie Beaufort, Jiang Li, Koki Tanaka, Marios K. Georgakis, Yunye He, Masaru Koido, Chikashi Terao, BioBank Japan, Christopher D. Anderson, Yoichiro Kamatani, Ramin Zand, Martin Dichgans; "Genetically proxied HTRA1 protease activity and circulating levels independently predict risk of ischemic stroke and coronary artery disease"; Nature Cardiovascular Research, 2024-5-20