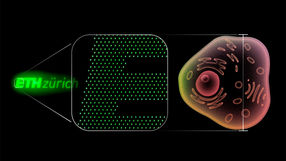La consommation d'alcool, quelle qu'en soit la quantité, augmente probablement le risque de démence
La consommation d'alcool, quelle qu'en soit la quantité, augmente probablement le risque de démence, selon la plus grande étude génétique et d'observation combinée à ce jour, publiée en ligne dans BMJ Evidence Based Medicine.
Même une consommation légère d'alcool - généralement considérée comme protectrice, d'après les études d'observation - n'est pas susceptible de réduire le risque, qui augmente en même temps que la quantité d'alcool consommée, indique l'étude.
La pensée actuelle suggère qu'il pourrait y avoir une "dose optimale" d'alcool pour la santé du cerveau, mais la plupart de ces études se sont concentrées sur des personnes plus âgées et/ou n'ont pas fait la différence entre les anciens buveurs et les non-buveurs à vie, ce qui complique les efforts pour déduire la causalité, notent les chercheurs.
Pour tenter de contourner ces problèmes et de renforcer la base de preuves, les chercheurs ont utilisé des données d'observation et des méthodes génétiques (randomisation mendélienne) provenant de deux grandes banques de données biologiques pour l'ensemble de la gamme de "doses" de consommation d'alcool.
Il s'agit du Million Veteran Program (MVP) des États-Unis, qui comprend des personnes d'origine européenne, africaine et latino-américaine, et de la UK Biobank (UKB), qui comprend des personnes d'origine principalement européenne.
Les participants, âgés de 56 à 72 ans au début de l'étude, ont été suivis depuis le recrutement jusqu'à leur premier diagnostic de démence, leur décès ou la date du dernier suivi (décembre 2019 pour le MVP et janvier 2022 pour l'UKB), selon ce qui s'est produit en premier. La période de suivi moyenne était de 4 ans pour le groupe américain et de 12 ans pour le groupe britannique.
La consommation d'alcool a été déterminée à partir des réponses au questionnaire - plus de 90 % des participants ont déclaré boire de l'alcool - et de l'outil de dépistage clinique AUDIT-C (Alcohol Use Disorders Identification Test). Cet outil permet de détecter les modes de consommation dangereux, y compris la fréquence des beuveries (6 verres ou plus à la fois).
Au total, 559 559 participants des deux groupes ont été inclus dans les analyses d'observation. 14 540 d'entre eux ont développé une démence de quelque type que ce soit au cours de la période de suivi : 10 564 dans le groupe américain et 3 976 dans le groupe britannique. Et 48 034 sont décédés : 28 738 dans le groupe américain et 19 296 dans le groupe britannique.
Les analyses d'observation ont révélé des associations en forme de U entre l'alcool et le risque de démence : par rapport aux petits buveurs (moins de 7 verres par semaine), un risque 41 % plus élevé a été observé chez les non-buveurs et les gros buveurs consommant 40 verres ou plus par semaine, pour atteindre un risque 51 % plus élevé chez les personnes dépendantes de l'alcool.
Les analyses génétiques par randomisation mendélienne se sont appuyées sur les données clés de plusieurs grandes études d'association à l'échelle du génome (GWAS) sur la démence, impliquant un total de 2,4 millions de participants, afin de déterminer les risques prédits par les gènes au cours de la vie (plutôt qu'au cours de la période actuelle).
La randomisation mendélienne exploite les données génétiques, en minimisant l'impact d'autres facteurs potentiellement influents, pour estimer les effets causaux : le risque génomique d'un trait (dans ce cas, la consommation d'alcool) remplace essentiellement le trait lui-même.
Trois mesures génétiques liées à la consommation d'alcool ont été utilisées comme différentes expositions, pour étudier l'impact sur le risque de démence de la quantité d'alcool, ainsi que de la consommation problématique et dépendante.
Ces expositions étaient les suivantes : consommation hebdomadaire déclarée (641 variantes génétiques indépendantes) ; consommation problématique "à risque" (80 variantes génétiques) ; et dépendance à l'alcool (66 variantes génétiques).
Un risque génétique plus élevé pour les trois niveaux d'exposition a été associé à un risque accru de démence, avec une augmentation linéaire du risque de démence plus la consommation d'alcool est élevée.
Par exemple, une consommation supplémentaire de 1 à 3 verres par semaine était associée à un risque plus élevé de 15 %. Et un doublement du risque génétique de dépendance à l'alcool était associé à une augmentation de 16 % du risque de démence.
Mais aucune association en U n'a été trouvée entre la consommation d'alcool et la démence, et aucun effet protecteur de faibles niveaux de consommation d'alcool n'a été observé. Au contraire, le risque de démence augmentait régulièrement avec la consommation d'alcool prédite par les gènes.
De plus, les personnes qui ont développé une démence ont généralement moins bu au cours des années précédant leur diagnostic, ce qui suggère que la causalité inverse - où un déclin cognitif précoce entraîne une réduction de la consommation d'alcool - sous-tend les effets protecteurs supposés de l'alcool constatés dans des études d'observation antérieures, affirment les chercheurs.
Ils reconnaissent que l'une des principales limites de leurs résultats est que les associations statistiques les plus fortes ont été trouvées chez les personnes d'ascendance européenne, en raison du nombre de participants de cette origine ethnique qui ont été étudiés. Ils ajoutent que la randomisation mendélienne repose également sur des hypothèses qui ne peuvent être vérifiées.
Néanmoins, ils suggèrent que leurs résultats "remettent en question la notion selon laquelle de faibles niveaux d'alcool sont neuroprotecteurs".
Et ils concluent : "Les résultats de notre étude confirment l'effet néfaste de tous les types de consommation d'alcool sur le risque de démence, aucune preuve ne venant étayer l'effet protecteur précédemment suggéré d'une consommation modérée d'alcool.
"Le modèle de réduction de la consommation d'alcool avant le diagnostic de démence observé dans notre étude souligne la complexité de l'inférence de la causalité à partir de données d'observation, en particulier dans les populations vieillissantes.
"Nos résultats soulignent l'importance de prendre en compte la causalité inverse et les facteurs de confusion résiduels dans les études sur l'alcool et la démence, et suggèrent que la réduction de la consommation d'alcool pourrait être une stratégie importante pour la prévention de la démence.
Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.